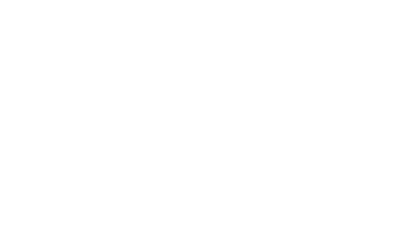The Bosom friend
Un film de Ulrich Seidl
Sortie en salles : 25 mars 2009
Film autrichien. Genre : Documentaire |
|
Durée : 1h09 min. Année de production : 1997 |
Image : 1,66 35 mm couleur
Pour Monsieur Rupnik, l’actrice allemande Senta Berger représente la « femme Frankenstein » idéale. Il a eu l’occasion de voir ses films une centaine de fois et d’étudier son corps pendant des années, déduisant des courbes mathématiques de sa poitrine. M. Rupnik a vécu « théoriquement » dix ans en compagnie de Senta Berger, mais en réalité il partage sa vie avec sa vieille mère.
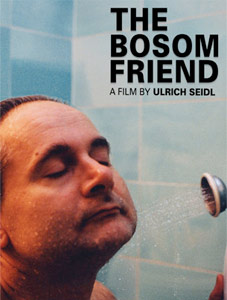
Le réalisateur, Ulrich Seidl
Ulrich Seidl, 55 ans, et sa douzaine de films, pour regarder vivre et “dé-vivre” un pays, l’Autriche contemporaine, n’est ni un jeune cinéaste ni une découverte. Mais sa manière d’enfoncer toujours le même clou — tout en variant les sujets, il filme à chaque fois de la même façon, selon une identique méthode, le même genre de personnages et d’histoire — donne l’impression au spectateur de se trouver en présence d’une oeuvre faite d’un seul long film, un continuum de malaise sarcastique, plutôt que face à une diversité d’opus illustrant des genres et des tons multiples. Voir un film de Seidl, c’est prendre ce train en marche — même parfois en pleine figure — celui d’un cinéma dur, sans concession, méchamment drôle, et pourtant authentiquement humain, mais fait d’un seul tenant, une seule rame, traversant l’Autriche de part en part en allant au bout de la voie. Là où ça ne fait pas que du bien. Lui-même n’est pas spécialement précoce. Il découvre sa vocation à 25 ans, suit les cours de l’école de cinéma à Vienne, puis dévore des films d’Eustache (l’un de ses premiers courts métrages lui est dédié, Le Bal en 1982, variation sur La Rosière de Pessac, plutôt l’Eustache d’Une sale histoire ou du Cochon), de Pasolini, de Herzog, ou pratique le travail photographique de Diane Arbus. Ses premiers essais documentaires, au début des années 1980 (Le Bal, Look 1984…) sont des reportages sur le vif en milieux populaires. Dans les dix longs métrages qui suivront, il tournera toujours avec prédilection dans les zones commerciales anonymes, les banlieues pavillonnaires petites bourgeoises, les carrefours urbains sans âme, les intérieurs ploucs ou les maisons froides, standard de l’habitat périurbain occidental qui nous apparaît comme le paysage révélateur du cinéaste. S’il fallait rapprocher cet univers de références qui nous sont familières, on évoquerait le Michael Haneke de 71 fragments du hasard ou de Benny’s video, régurgitant l’Autriche à travers la normalisation de ses pulsions scopiques, les photos monumentales d’Andreas Gursky, comme si Seidl avait pour but de zoomer sur quelques personnages dans une foule saisie par l’artiste allemand, ou encore l’approche entomologiste de la barbarie intime d’un pays telle que la pratiquait l’écrivain Thomas Bernhard. En 1989, avec Good News, vendeurs de journaux, chiens morts et autres Viennois, Seidl fixe à la fois sa méthode et son domaine d’observation. Ses films, dorénavant, fonctionneront toujours comme des récits de vie croisés, chacun d’entre eux arraché à la réalité de la société autrichienne, les intrigues étant strictement indexées à l’observation de cas particuliers. Là, dans Good News, il suit plusieurs vendeurs de journaux pakistanais l’hiver, emmitouflés dans leur tenue jaune siglée d’un énorme K rouge, comme “Keep smiling, Keep selling”, leur mot d’ordre, et comme “Kronen Zeitung”, le hideux journal à deux sous qu’ils diffusent. Le film intègre les vies de ceux qui ingèrent cette presse décervelante, des vieux, des vieilles, des gras, tous ceux qui, avec une lucidité acerbe, lancent un jour en ouvrant le canard : “Toujours rien sur nous, on est pourtant en train de crever quand même…” Il visite aussi la table d’opération d’un vétérinaire qui pique les chiens pour les faire mourir davantage qu’il ne semble les soigner. Si bien que le passage des rues froides de la ville à la mosquée où prient les vendeurs pakistanais, du salon de coiffure où on lit la presse à la plaque de métal où agonisent les bêtes, n’est possible qu’à travers une construction à la fois aléatoire et rigoureuse, où les “bonnes nouvelles” font office de fil directeur, celles qui annoncent comment le monde ne va pas bien, comment les hommes vivent et meurent au coin de la rue et dans des guerres aussi lointaines que dépourvues de sens, comment s’achèvent les pauvres existences des chiens écrasés. Non sans variante mais avec une cohérence absolument fidèle à ces prélèvements de désespoir dans la banalité ambiante, Seidl filme les passages à un poste frontière entre Autriche et Tchécoslovaquie dans Losses to Be Expected, où un veuf cherche et observe à la jumelle sa future promise de l’autre côté de la ligne de séparation ; puis les amours de plusieurs maîtres et maîtresses avec leur chien, dans Animal Love, version hard, même zoophile, de L’Empire de Médor, où Luc Moullet filmait avec la même ironie mordante la “Kultur” du Toutou. Suivent les tribulations cocaïnées, laborieuses et sexuelles, de quelques modèles blondes dans Models, en 1998, entre séances photos et boîtes de nuit, gueule de bois du matin et corps refaits, vidés, habillés, maquillés, sanglés, dénudés selon les règles de la consommation des chairs. Dans Dog Days, le film à ce jour le plus connu de Seidl, Grand prix à la Mostra de Venise en 2001, six histoires de “gens ordinaires” s’entrecroisent sous le soleil caniculaire de l’été autrichien : un vendeur de systèmes d’alarme qui transpire en faisant du porte à porte dans la banlieue pavillonnaire ; une prof sadisée par deux amants loubards dont elle ne peut pas se passer ; un veuf obsédé par la sécurité, son chien et l’exactitude, vouant un tel culte à son épouse disparue qu’il finit par aduler la femme de ménage qui joue périodiquement son rôle ; Klaudia, jolie fille blonde Neue Mitte qui se fait torgnoler par son amant macho ; un couple divorcé qui continue à vivre sous le même toit après la perte de leur enfant, mais en menant des vies complètement parallèles ; et donc Anna-la-foldingue. Jesus, tu sais, en 2003, fait quant à lui défiler les fous du Christ dans les églises de Vienne, qui prient et prêchent leur foi face à la caméra. À chaque reprise, la même question pourrait se reposer : est-on face à un documentaire ou une fiction ? Elle n’a évidemment pas d’intérêt. Car de l’observation de la réalité naissent des histoires, et ces scènes de la vie matérielle sont toutes entièrement imbriquées dans le tissu social contemporain : la frontière entre documents et fiction n’existe plus. Ou plutôt, cette limite n’est qu’une pure question technique, financière. Seidl a commencé dans le documentaire car cela coûtait moins et le faisait rêver plus. La frontière entre les genres existe tellement peu chez lui qu’acteurs amateurs et professionnels peuvent se mêler et côtoyer ceux qui tiennent leur propre rôle. Dans Dog Days, le vendeur d’alarmes est un vrai vendeur d’alarmes, le couple détruit est un vrai couple détruit, et seules la professeure sadisée et Anna-la-foldingue sont des comédiennes. Mais il semblerait que la première aime se faire insulter et que la seconde soit vraiment folle. Par contre, acteur ou non, documentaire ou fiction, le regard de Seidl demeure identique. Voici la vraie cohérence de l’oeuvre. Seidl a littéralement le regard brechtien : son oeil met à distance à travers une frontalité assumée. Dans Models, ce regard est central : l’oeil de Seidl, sa caméra, occupe littéralement la place du miroir. Là où les filles ne cessent de se regarder elle-mêmes, pour se maquiller, se confier, se défier, se jauger, se voir tout simplement, dans la logique du narcissisme froid et du jugement sans complaisance qui gouverne ce film, et tous ceux du cinéaste : “Je suis moche, je suis grosse, j’ai pas assez dormi, je suis explosée de drogue, je suis séduisante, je suis pute, je suis vraie parce que je suis fausse…” Cette frontalité sans tabou, ce cadre acéré comme une fenêtre de guillotine, cette fixité scrutatrice, cette durée rigoureuse qui va sans cesse au-delà du temps normal du plan, donnent au regard de Seidl une distance où les personnages, à la fois, se montrent comme ce qu’ils sont, sans détour, et se révèlent dans leur misérable humanité, toujours. Seidl n’est pas un sadique, ce qu’il traque n’est pas la souffrance pour la souffrance, mais la meurtrissure qui mène à la vie révélée. L’émotion même, parfois : une vieille femme qui danse maladroitement dans la robe d’une autre. Ce que regardent les six films d’Ulrich Seidl, avec leur méchanceté rieuse, est une société contemporaine en déroute. Que Thomas Bernhard définissait ainsi dans Simplement compliqué : “Où que nous regardions, nous ne voyons qu’une humanité délirant de pouvoirs. Nous sommes au coeur d’un processus catastrophique de crétinisation.” Aucun mépris chez le cinéaste, mais un constat : il s’agit de filmer comment l’espèce humaine, et spécialement l’homo autrichianus, s’adapte de façon exceptionnelle et démoniaque à ce processus de déréliction vers le pire. Comment l’habitat, les habitudes, l’habillement, le sexe, les corps, les moeurs, se plient avec des trésors d’énergie et d’invention aux dévoiements contemporains d’une normalité endémique. Seidl l’avoue avec franchise : montrer l’état de bonheur ne l’intéresse pas, il n’est pas un “cinéaste de mariage”. Par contre, regarder la norme façonner nos comportements est son sujet. Et c’est cela qui choque, car “il se trouve que la réalité, dans la plupart des cas, est très dérangeante pour le spectateur”.Antoine de Baecque