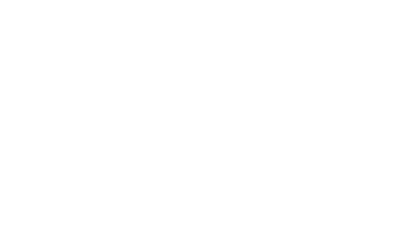Olivia de Jacqueline Audry sort sur les écrans français le 27 avril 1951. Ce cinquième long métrage de la réalisatrice est une adaptation d’un roman au léger parfum de scandale de la Britannique Dorothy Bussy, paru deux ans auparavant. Bien que porté par deux grandes stars du cinéma français (Edwige Feuillère et Simone Simon), il n’a pas été simple à produire. Pas grand monde ne voulait entendre parler de cette comédie dramatique sur l’éveil spirituel et charnel de jeunes pensionnaires d’une institution bourgeoise tenue par un couple de femmes. L’action se déroule à la toute fin du XIXe siècle. L’homosexualité féminine n’est pas ici envisagée comme un sujet, ni vraiment un thème à défendre, les personnages assumant sans ambages leur préférence sexuelle. Ainsi, Mesdemoiselles Julie (Edwige Feuillère) et Clara (Simone Simon), les deux directrices, ne cachent rien de leurs sentiments respectifs l’une envers l’autre. Les jeux de séduction et de jalousie avec leurs protégées sont vécus comme un apprentissage « classique » des passions.
La « Olivia » du titre est une jeune pensionnaire britannique (Marie-Claire Olivia) dont l’arrivée va troubler l’équilibre du lieu et faire vaciller le cœur de Julie. Olivia, amoureuse de son aînée, s’interroge auprès d’une de ses camarades : « Dis-moi ce que c’est d’être amoureux ! » Pour seule réponse, son amie lui rétorque avec une suggestivité malicieuse : « Non, c’est trop horrible pour en parler, trop délicieux pour y penser. » Dans ce film, les hommes n’ont pas leur place et il faudra avoir recours au travestissement le temps d’un bal costumé à la pension pour que la gent masculine soit finalement représentée.
Dans son autobiographie, Les Feux de la mémoire (Albin Michel), Edwige Feuillère raconte cette anecdote. À la sortie d’Olivia, un tapissier employé dans son appartement pour une rénovation se lamente auprès de la comédienne : « Si je ne peux plus emmener ma fille voir un film d’Edwige Feuillère… » L’intéressée ne se démonte pas et lui répond que cette histoire d’amour au féminin n’est tout de même pas un crime. Indignation de son interlocuteur : « Le meurtre, c’est propre au moins ! »
Olivia, longtemps oublié des livres d’histoire de cinéma – comme le nom de sa réalisatrice d’ailleurs –détonne dans le cinéma français de l’époque. Sa modernité saute encore aujourd’hui au visage. Ce cri du cœur lancé par l’une des héroïnes « Enfin, ici on est libre ! », résonne jusqu’à nous.
Trouver sa place
En ce début des années 50, Jacqueline Audry vient de signer coup sur coup deux adaptations cinématographiques très remarquées de Colette : Gigi (1949) et Minne, l’ingénue libertine (1950). Sa place dans l’industrie du cinéma n’est plus vraiment discutée, pourtant son Olivia inquiète les investisseurs potentiels. « Ce film dont le sujet exige beaucoup de goût et de doigté… », peut-on lire sur un document d’époque envoyé à la production qui semble traduire, sinon un refus de financement, du moins quelques réticences. Pour Jacqueline Audry, « chaque femme se reconnaîtra dans Olivia », et l’idée de batailler pour imposer son film ne lui fait pas peur. C’est juste un combat de plus dans une carrière de cinéaste où les barrières ne cessent de se dresser devant elle.
Jacqueline Audry naît en 1908 à Orange dans le Vaucluse au sein d’une famille protestante. Son père est préfet. Le grand-oncle de la famille n’est autre que Gaston Doumergue, président de la République entre 1924 et 1931. Elle a une sœur, Colette, de deux ans son aînée, qui deviendra une figure de la Résistance et du féminisme, proche du couple Simone de Beauvoir – Jean-Paul Sartre. Devenue cinéaste, Jacqueline portera à l’écran l’une des pièces de sa sœur, Soledad sous le titre Fruits amers (1967), récit d’une combattante blessée dans son honneur, avec Emmanuelle Riva et Laurent Terzieff.
En attendant, la jeune fille se contente de rêver de cinéma et revendique même un côté midinette. Avant de fouler les plateaux de tournage en ce début des années 30, sa seule ambition est de devenir actrice. « Je croyais qu’il n’y avait pas d’autre place pour une femme dans ce monde -là ! », avoue-t-elle rétrospectivement dans une interview. C’est donc sans trop d’illusions qu’elle pousse les portes d’une industrie exclusivement dirigée par des hommes et accepte de jouer « les bouche-trous » puis les scriptes, dont on préfère à l’époque utiliser le terme anglais script-girl, ne laissant aucun doute sur le profil recherché. Méthodique et efficace, Jacqueline Audry franchit un cap en devenant « assistant-réalisateur », poste dont personne n’a encore songé à lui donner un équivalent féminin. Elle assiste ainsi Max Ophüls pour Le Roman de Werther (1938) ou encore Georg Wilhelm Pabst sur Jeunes Filles en détresse (1939).
Muraille de Chine
Audry ambitionne désormais de réaliser des films et a sûrement en tête le nom de ses aînées, Alice Guy ou Germaine Dulac. Deux femmes cinéastes, deux exceptions. L’intrépide se souviendra toutefois de la façon dont elle a créé un silence de mort sur un plateau suivi d’un éclat de rire retentissant après avoir avoué son désir de devenir réalisatrice. Qu’importe, installée à Nice durant l’Occupation, elle intègre une école de cinéma, signe un court métrage documentaire (Les Chevaux du Vercors avec Henri Alekan à la lumière) et prépare déjà le grand saut, une adaptation des Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. En 1946, le film sort sur les écrans. Jacqueline Audry est une cinéaste. La seule, ou presque. Outre-Atlantique, au même moment, Ida Lupino signe des films noirs où les femmes malmenées se battent pour continuer de vivre dignement. Pour la Française, ce n’est pas assez. Audry, elle, parle de destins féminins, d’héroïnes qui parviennent à sortir d’un univers cloisonné pour se libérer des normes et embrasser la vie qu’elles désirent ardemment. La lecture émancipatrice des romans de Colette lui sert de guide. Ce sera donc des adaptations de Gigi et Minne, l’ingénue libertine puis Mitsou en 1956, coécrit avec la complicité de son mari Pierre Laroche. Lors d’une émission télévisée, un journaliste vient à la rencontre de la réalisatrice avec cette métaphore en bandoulière : « S’il est déjà difficile pour un homme de devenir metteur en scène, pour une femme ce doit être un peu comme la muraille de Chine pour un maçon… » Courtoise et bien élevée, Jacqueline Audry répond avec douceur et confirme que, oui, une carrière comme la sienne s’est construite face à des vents contraires.
Un féminisme qui s’impose de lui-même
Jacqueline Audry est l’unique réalisatrice française de longs métrages de fiction dans l’immédiat après-guerre. Il faudra attendre Agnès Varda et l’émergence de la Nouvelle Vague pour voir une autre femme s’imposer. Elle est également la première cinéaste à intégrer le jury du Festival de Cannes en 1963, celui qui remettra la Palme d’or au Guépard de Luchino Visconti et surtout un prix d’interprétation féminine à Marina Vlady pour son rôle dans la comédie sulfureuse et iconoclaste Le Lit conjugal de Marco Ferreri. Adepte des films en costumes et des tournages en studio, Audry pâtit d’être une représentante de la « qualité française », disqualifiée par la jeune génération : Truffaut, Godard et les autres. Dans les pages culture de la revue Arts, le critique et futur cinéaste Éric Rohmer se gaussait d’une mise en scène « médiocre » ne voyant pas que sous le vernis prétendument classique se cachait un féminisme d’autant plus puissant qu’il n’était pas brandi en étendard mais s’imposait de lui-même. Ce qui n’empêchera pas Pierre Braunberger, producteur des Films de la Pléiade (société ayant produit tous les tenants de la Nouvelle Vague), d’acheter Olivia à Memnon Films en 1960.
Vertige des sens
Il suffit pourtant de se pencher sur les histoires que Jacqueline Audry met en scène pour saisir les préoccupations d’une auteure à part entière. Outre les films déjà cités, il y a Huis clos d’après Sartre (1954) ; La Garçonne (1957), itinéraire d’une jouisseuse libre et extravertie ; L’École des cocottes (1958) autour d’une ambitieuse décomplexée ; le road-movie d’inspiration Nouvelle Vague Les Petits Matins (1962), échappée solitaire d’une jeune fille à la recherche du bonheur ; ou encore l’expérimental Le Lis de mer (Vanina) (1969), film fiévreux inspiré d’un roman de l’écrivain surréaliste André Pieyre de Mandiargues sur le désir et le vertige des sens, tourné sous le soleil pénétrant de la Sardaigne. Dans ce corpus, se trouve aussi un film de cape et d’épée, Le Secret du chevalier d’Éon (1960), preuve s’il en fallait que le cinéma d’action n’est pas seulement l’affaire des hommes.
En trente années de carrière, Jacqueline Audry aura dirigé Danièle Delorme, Gaby Morlay, Edwige Feuillère, Simone Simon, Arletty, Michel Auclair, Pierre Brasseur, Lino Ventura ou encore Bernard Blier, réalisé dix-sept longs métrages dans des genres très différents et dont certains ont largement dépassé le million d’entrées (3 pour Gigi)… Mais ce parcours exceptionnel ne suffira pourtant pas à lui garantir une quelconque postérité. Pire, le nom de Jacqueline Audry, décédée prématurément dans un accident de la route en 1977, disparaît des manuels et il faudra attendre une rétrospective lors du Festival international de films de femmes de Créteil en 2015 pour que la cinéphilie entreprenne un lent travail de réhabilitation. En 2018, une copie restaurée d’Olivia projetée au Festival Lyon Lumière et une exploitation dans toute la France dans la foulée permettent de mesurer l’audace folle d’une artiste qui, bien avant que l’on ne parle de « regard féminin » au cinéma, a toujours accompagné ses héroïnes sans jamais baisser les yeux. Brigitte Rollet, auteure de l’ouvrage Jacqueline Audry, la femme à la caméra (Presses universitaires de Rennes), affirme ainsi : « C’est sans doute la première cinéaste qui s’est à ce point adressée aux femmes du public dans ses films en permettant une identification très positive. »
Olivia de Jacqueline Audry a bénéficié du soutien du CNC dans le cadre du plan de numérisation et de restauration des films du patrimoine.