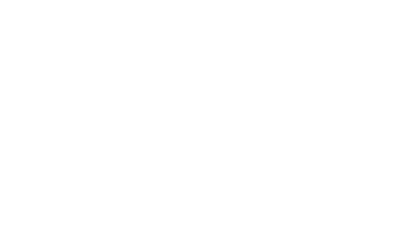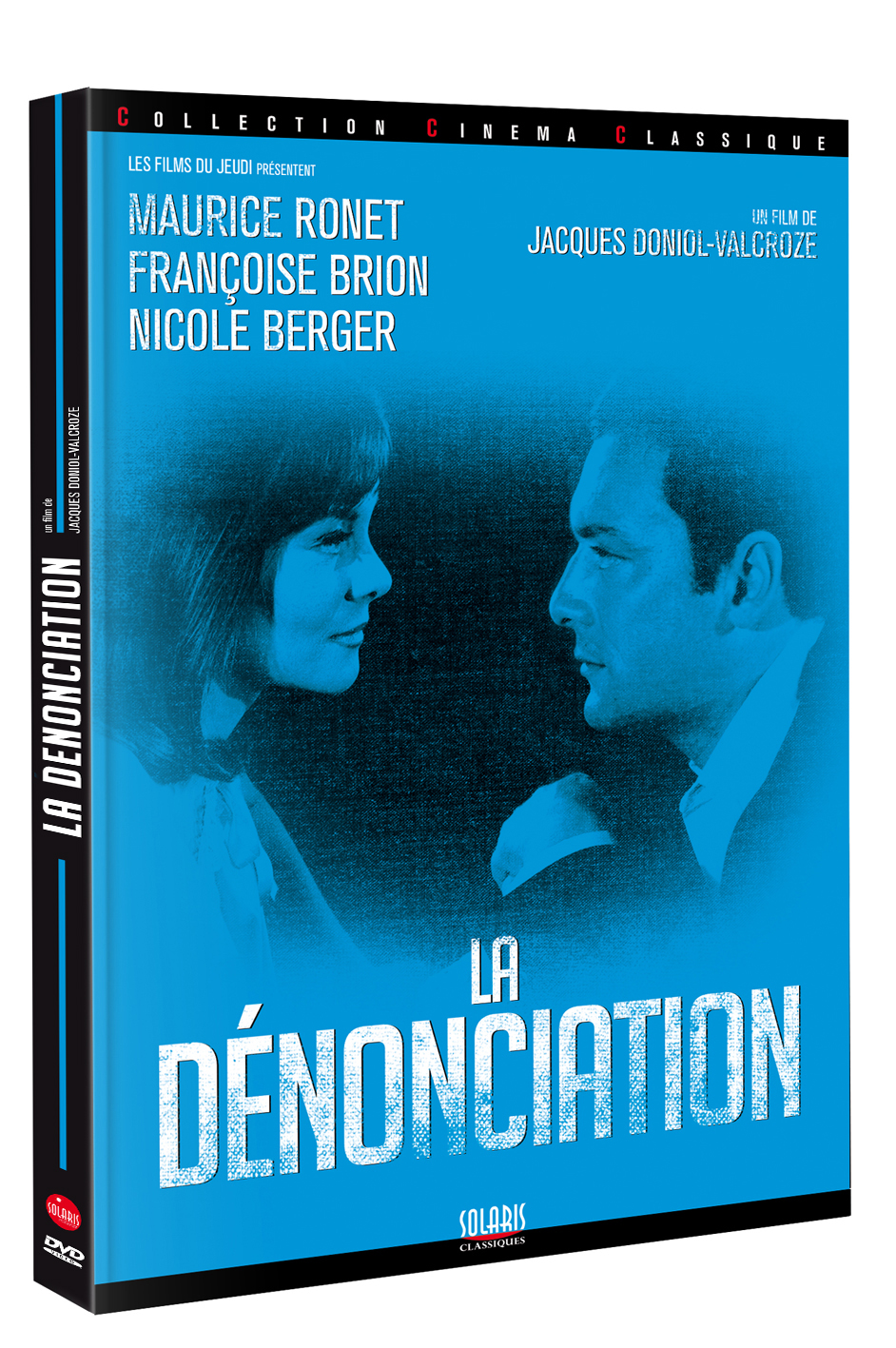LA DENONCIATION : L'innocence brisée
Troisième long métrage de Doniol-Valcroze, La Dénonciation est sans doute son film le plus ambitieux, mais aussi le plus – injustement – méconnu. Comme ses camarades Chabrol et Truffaut, le cinéaste est visiblement inspiré par Hitchcock qui, on le sait, est passé maître pour croiser intrigue policière, enjeux politiques et drame psychologique. Dans ce récit d’une noirceur à laquelle renvoient les clairs obscurs et les éclairages expressionnistes, Doniol-Valcroze orchestre une formidable variation autour du thème hitchcockien du “faux coupable”. Pourtant, Michel Jussieu est-il vraiment innocent ? Certes il a été le témoin accidentel d’un crime auquel il est totalement étranger. Mais hanté par son passé de délateur, il voit dans ce hasard l’occasion d’une possible rédemption. Et alors même qu’il est foncièrement hostile à l’extrême-droite, il préfère taire le nom des assassins, visiblement proches de l’OAS, que de les dénoncer. À cet égard, La Dénonciation est une fascinante réflexion sur la porosité entre innocence et culpabilité.
Plongeant dans les méandres de l’esprit de Jussieu, le cinéaste convoque la voix-off hypnotique de Laurent Terzieff, les plans serrés sur le visage grave de Maurice Ronet et surtout un montage sinueux, mais incroyablement fluide, où les temporalités s’enchâssent comme le flux des pensées qui nous traversent à tout moment. Invitant le spectateur à une gymnastique intellectuelle jubilatoire, Doniol-Valcroze saisit avec une étonnante modernité le cheminement psychologique et affectif du protagoniste jusqu’à son funeste destin. Rarement aura-t-on filmé de manière aussi vertigineuse les atermoiements de l’âme, le déchirement qui nous étreint face à un dilemme moral et l’omniprésence obsédante d’un passé cruel qui se refuse à s’estomper.
À rebours du Paris insouciant du début des années 60, le cinéaste dépeint une ville fantomatique où les personnages glissent comme des ombres et où les rues sont quasi désertes. Il faut voir ce plan saisissant où Maurice Ronet avance, comme un spectre, dans une avenue Victor Hugo presque vide. Car, une fois encore, c’est à une déambulation intérieure que nous convie Doniol-Valcroze, évocatrice de l’errance mélancolique de Jeanne Moreau dans Ascenseur pour l’échafaud. Aux côtés d’un Ronet d’une exceptionnelle densité, il faut saluer le jeu insolite et savoureux de Sacha Pitoëff en commissaire outrancièrement courtois. Une pépite de la Nouvelle Vague à redécouvrir de toute urgence.
MAURICE RONET : Le dandy élégant
D’Ascenseur pour l’échafaud à Plein soleil, du Feu follet à La piscine, Maurice Ronet n’a cessé de fasciner par sa présence ténébreuse et énigmatique. Né en 1927 de deux parents comédiens, il se passionne très tôt pour la littérature et notamment Edgar Poe et Melville. S’imaginant peintre ou écrivain, il se révèle musicien doué, mais finit par suivre les cours d’art dramatique de la rue Blanche. Dès son premier rôle dans Rendez-vous de juillet (1949) de Jacques Becker, il accède à la notoriété. Mais c’est en interprétant Julien Tavernier dans le monumental Ascenseur pour l’échafaud (1958) de Louis Malle qu’il entre dans la légende : ouvrant la voie aux personnages tragiques et désespérés, assassins ou victimes, il incarne aussi un homme suicidaire dans Le feu follet (1963), de nouveau sous la direction de Louis Malle.
Interprète de Claude Chabrol, de La ligne de démarcation (1966) au Scandale (1967), de La route de Corinthe (1967) à La femme infidèle (1969), il sait aussi camper un libertin réjouissant dans Raphaël ou le débauché (1971) de Michel Deville. Extravagant dans la vie comme à l’écran, il se sera frotté à tous les genres et à tous les cinémas, des auteurs de la Nouvelle Vague aux productions plus commerciales. Chemin faisant, il aura aussi donné la réplique aux plus grandes stars de son époque, comme Alain Delon, Jeanne Moreau ou Romy Schneider. Il disparaît en pleine gloire à l’âge de 55 ans des suites d’un cancer.
JACQUES DONIOL-VALCROZE : le trouble de l'âme
Né en 1920, Jacques Doniol-Valcroze décide de devenir cinéaste après la guerre. Collaborateur à La Revue du cinéma aux côtés de Jean-Georges Auriol à la fin des années 40, il anime un ciné-club, Objectif 49, avec Jean Cocteau, Alexandre Astruc, André Bazin et Pierre Kast. En 1951, il fonde les Cahiers du cinéma dont il partage la rédaction avec Lo Duca. Accueillant les futurs cinéastes de la Nouvelle Vague, la revue permet à Doniol-Valcroze de poursuivre une double carrière de comédien et de réalisateur. Il signe ainsi L’eau à la bouche en 1959, amusant marivaudage autour d’un héritage, puis enchaîne avec Le cœur battant (1960), charmante comédie libertine, et La Dénonciation (1962), dont la tonalité beaucoup plus sombre le rattache à Truffaut et Hitchcock.
Il réalise ensuite Le Viol (1967), La Maison des Bories (1970), L’homme au cerveau greffé (1971) et Une femme fatale (1977). Marqué par une lucidité qui le porte au tragique, le cinéaste porte un regard désabusé sur une époque qu’il juge absurde. Et sous couvert d’une apparence insouciance, il orchestre de savants jeux de couples en proposant une passionnante réflexion sur la lâcheté et la jalousie. Sans jamais céder au moindre manichéisme. Il disparaît en 1989.
Texte : Frank Garbaz