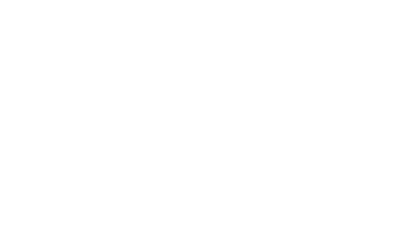Bertolt Brecht et Fritz Lang à Hollywood, pour un film noir évoquant l'âme de la Résistance tchèque
LES BOURREAUX MEURENT AUSSI
Un film de Fritz LANG
Sortie en salles : 26 avril 2023
1943 | USA | Drame/Thriller | 2h14 | 1,37 | mono
Visa n°5465
En 1942 à Prague, pendant l’occupation nazie, le Reichsprotektor Heydrich, surnommé « le bourreau », est assassiné par le docteur Svoboda, membre de la résistance tchèque. Poursuivi par la Gestapo, il est aidé par une jeune femme, Mascha Novotny, dans la famille de laquelle il se réfugie très vite sous une fausse identité. Mais, par répression et pour obliger le peuple praguois à dénoncer l’assassin, la Gestapo s’empare de plusieurs centaines d’otages qu’elle menace d’exécuter. Parmi eux, le professeur Novotny, père de Mascha.

— Galerie
A propos du film :
Fin mars 1933, avant même la distribution publique en Allemagne du Testament du Docteur Mabuse, le film est interdit par le Ministère de la Propagande, dirigé depuis l’accession au pouvoir d’Hitler par Joseph Goebbels. Celui-ci convoque très vite Fritz Lang, mais après avoir rapidement évoqué cette interdiction, Goebbels lui propose surtout la direction du Département V de son ministère, celui consacré au cinéma, précisant que le chancelier apprécie énormément Metropolis ou Die Niebelungen. Lang, qui est manifestement conscient depuis des années du danger que représentaient les nazis (d’aucuns voient des évocations directes de cette menace dans M ou Mabuse), et qui tient à son indépendance, refuse poliment, prétextant que sa mère est d’origine juive. Goebbels lui répond : « Ce qui est juif, nous en déciderons. » Le soir même, Lang fait ses valises et fuit l’Allemagne, pour la France d’abord, puis pour les Etats-Unis. Là, bien qu’obtenant la nationalité américaine et n’envisageant pas de retourner en Allemagne tant que les Nazis seront au pouvoir, il demeure très préoccupé par l’actualité européenne et fréquente des groupes d’émigrés allemands de plus en plus nombreux. Leurs témoignages confortent sa haine du nazisme, et il devient alors indispensable pour l’artiste qu’il est de participer, à sa manière, à la prise de conscience collective et au combat contre Hitler. A partir de 1939, la plupart des projets cinématographiques auxquels il s’attèle (Man Hunt, Men Without a Country qui ne se fera pas, Confirm or Deny finalement réalisé par Archie Mayo) sont ainsi directement dirigés contre le nazisme. Par ailleurs, Lang participe à l’organisation de l’exil et de l’accueil d’anciens compatriotes ayant comme lui fui l’Allemagne. Parmi eux, le dramaturge Bertolt Brecht, réfugié en Scandinavie jusqu’en 1941, et qui arrive à Hollywood avec l’envie de collaborer avec Fritz Lang à ce qui est concrètement devenu un effort de guerre.
Genèse du scénario :
Le 27 Mai 1942, le Reichsprotektor praguois Reinhard Heydrich est assassiné. Dès le lendemain, et alors que les circonstances (1) de l’attentat sont encore méconnues aux Etats-Unis, Lang propose à Brecht de partir de cet événement pour réfléchir à une histoire d’otages qui mettrait en valeur la résistance tchèque. Le journal de travail de Berthold Brecht, abondamment annoté, nous renseigne sur l’évolution de leur collaboration : ainsi y apprend-on que les deux hommes collaborent dans un premier temps à raison d’une dizaine d’heures par jour, et qu’ils ne fonctionnent pas tout à fait selon les mêmes principes. Brecht, en particulier, n’accepte guère les concessions à la vraisemblance que Lang opère, tout en prétendant savoir ce que le public acceptera ou pas. Il note ironiquement qu’il est « intéressant qu’il (Lang) soit bien plus intéressé par les surprises que par les tensions » et déplore plus tard « une camelote d’une infinie tristesse ; que de schémas, d’intrigues, de faussetés ! » Lang, en effet, ne s’embarrasse guère de psychologie dans l’élaboration du scénario : il agit dans l’urgence d’un effort qui consiste avant tout à alerter le public américain de l’horreur nazie, et cela passe aussi par des concessions au spectaculaire.
Un autre problème s’ajouta à cela : Brecht, qui se considérait toujours un auteur allemand et avait hâte de rentrer au pays, avait refusé d’apprendre un anglais suffisamment correct pour la rédaction d’un scénario. Il était par ailleurs selon les principes de Lang – pour diverses raisons, dont sa connaissance approximative de l’anglais – de toujours s’accompagner depuis son arrivée à Hollywood d’un coscénariste maîtrisant mieux que lui la langue des producteurs. Après avoir négocié avec Arnold Pressburger, producteur du projet, le salaire de Brecht, Lang se vit donc adjoindre un nouveau co-auteur, en la personne de John Wexley, lequel était en vogue depuis le succès de sa pièce The Last Mile et parlait allemand qui plus est. Si le rôle de chacun, qui varie selon les témoignages, demeure indéfini, il est manifeste que la collaboration fut houleuse, tant pour l’écriture qu’à un niveau plus politique (le communiste Wexley trouvait Lang trop peu « à gauche », et Brecht semblait incapable de s’adapter aux attentes idéologiques comme commerciales du public américain). De plus, le trio eut tendance à s’entre-déchirer : Wexley et Brecht réécrivirent ensemble une partie du scénario, ce qui rendit Lang furieux quand il l’apprit. Il prit Wexley à part pour lui expliquer qu’ils faisaient un film « pour Hollywood » et dès lors, Wexley édulcora les scènes avec le peuple tchèque auxquelles Brecht tenait tant (2) et réintroduisit dans le scénario des séquences qu’il avait rayées sous les yeux de Brecht. Lequel Brecht désapprouvait les orientations du casting choisi par Lang. (3) Enfin, il s’avéra que, pour des raisons imprécises, Wexley signait de son seul nom les pages coécrites avec Brecht. Il obtint dès lors des rémunérations beaucoup plus importantes et un crédit unique comme scénariste au générique du film, ce qui mit Brecht hors de lui. La Screen Writers Guild, malgré le soutien de Lang et de Pressburger, arbitra en faveur de Wexley sous prétexte qu’il en avait d’avantage besoin que Brecht, dont la renommée n’était plus à faire – surtout en Allemagne, en fait… Finalement, Lang se démena pour que Brecht soit crédité comme « auteur du sujet original ».
Ceci étant, il est bien difficile de faire la part des choses dans Les Bourreaux meurent aussi concernant l’apport de chacun. Lang estimait – après coup – que 90 % du scénario définitif était brechtien, mais ce dernier, trahi, lésé, ne se reconnaissait pas dans ce « magma d’images », même s’il concédait que ce qu’il appelait le « Lang-film » lui avait « donné de l’oxygène » pour écrire de nouvelles pièces. A la vision du film, on devine bien, notamment dans la dernière partie, une réflexion sur le mensonge ou la culpabilité très langienne. Par ailleurs, une certaine théâtralisation du réel, notamment dans les scènes réunissant les otages ; le didactisme militant de certaines tirades ; ou la structure épique d’un film qui embrasse le destin collectif de tous les praguois, sont eux assez caractéristiques du style de Bertolt Brecht. Toutefois, la construction du film paraît aujourd’hui assez bâtarde ; et les nombreuses pistes, loin de participer à l’ample portrait d’une communauté, s’affaiblissent souvent les unes les autres en alourdissant quelque peu l’intrigue. En tout état de cause, si l’ambition commune qui avait initialement animé Brecht et Lang est manifeste, Les Bourreaux meurent aussi souffre désormais, en quelque sorte, de l’urgence contextuelle dont il était issu. Sans relativiser ni l’absolue nécessité du film à son époque ni son incontestable intérêt historique aujourd’hui, il semble au strict point de vue dramatique bien inférieur à de nombreux autres travaux de ses auteurs (4), à l’instar, finalement, des films “de propagande” (pour résumer) qu’Alfred Hitchcock tourna également à la même époque.
(par Antoine Royer/DVDclassik)
Analyse : (par Antoine Royer)
Les Bourreaux meurent aussi ne sortit en France qu’en 1947, soit cinq ans après sa conception et deux ans après la fin de la guerre, dans une période où la plupart des films américains réalisés au début de la décennie devenaient enfin visibles. Trop long et probablement considéré comme ayant perdu de son actualité, le film fut remonté dans une version d’exploitation vingt minutes plus courte.
Sans parler de considérations techniques, il peut être intéressant de s’attarder sur les différences, sur ce que les remonteurs français de 1947 avaient estimé dispensable. On découvre alors que, si l’intrigue fondamentale demeure (la mort de Heydrich, la traque de Svoboda, le personnage de Mascha, le traître Czaka), a disparu l’essentiel de ce à quoi Brecht était attaché, à savoir l’implication du peuple praguois au-delà des simples résistants et la majeure partie de l’histoire des otages.
Affadissant encore le propos brechtien du film, ce choix semble surtout marquer la volonté, pour la France de l’immédiat après-guerre, d’exorciser les fantômes persistants du proche passé pour se concentrer avant tout sur la dimension spectaculaire du film. Il n’était nul besoin de rappeler à un peuple meurtri les bienfaits de la résistance collective, il fallait surtout tenter de panser les plaies d’une nation.
Là où les auteurs s’étaient concentrés sur les valeurs mobilisatrices d’une œuvre, Les Bourreaux meurent aussitel qu’il fut présenté en France pendant plusieurs décennies était donc davantage un film à suspense prenant pour cadre la cité praguoise occupée. Evidemment, avec Fritz Lang aux manettes, ce film à suspense, présent en filigrane dans la version complète, demeure par bien des aspects au-dessus du tout-venant cinématographique de l’époque. Cela vient tout d’abord d’une mise en scène qui, si elle semble parfois bridée par le sujet, n’oublie jamais le sens de la composition ou de la lumière de son auteur. Des plans extrêmement contrastés, proche de l’expressionnisme mais sans sa dimension onirique, viennent ainsi parfois souligner la gravité des situations (pendant l’interrogatoire de Mme Dvorak, la lecture de la lettre du Professeur Novotny…). Le monteur du film, Gene Fowler Jr., âgé au moment du film de 25 ans, témoignait vingt plus tard de l’extraordinaire perfectionnisme de Fritz Lang : « Intolérant vis-à-vis de tout ce qui n’est pas un travail de professionnel, il réclame de tous ceux qui travaillent avec lui de partager sa recherche de la perfection. » Souci qui s’accompagnait, étant donné la teneur même des Bourreaux meurent aussi, d’une volonté de réalisme : « Nous devions tourner une scène où, capturé par la Gestapo, un homme se suicide en sautant à travers une fenêtre. Dans un tel cas, on utilise un verre spécial à base de sucre, afin d’éviter toute blessure du cascadeur. Nous étions en guerre, le sucre était rationné et nous dûmes nous passer de ce verre. Lang devait donc choisir : soit utiliser une vraie vitre, soit complètement s’en passer, ce qu’il fit. Lorsque notre homme sauta, le résultat fut ce qu’il devait être : un échec. Afin de rendre les choses plus réalistes, nous utilisâmes une pellicule à grain fin (utilisée pour obtenir des contretypes négatifs) et Lang et moi projetâmes des fragments de vitre dans le champ. Le résultat fut surprenant, et à mon avis supérieur à ce que nous aurions obtenu avec une vitre comme on en utilise d’habitude ! » (Par ailleurs, il semblerait que des stries aient été rajoutées manuellement sur plusieurs photogrammes pour donner l’illusion de l’éclat).
On retrouve ensuite des récurrences de l’art langien dans sa façon de jouer avec les nerfs du spectateur par le biais de l’ironie dramatique. Ainsi, comme souvent chez Lang, le mensonge et l’illusion font partie intégrante du combat des Résistants, alors que le traître Czaka est confondu aux seuls instants où la vérité sort de sa bouche. Malgré tout, toujours au nom du suspense, on frôle parfois l’exagération, ce qui avait le don d’agacer Brecht. Ainsi, alors que les inspecteurs de la Gestapo ont placé des micros pour écouter la conversation entre Mascha Novotny et Svoboda, et que celle-ci s’apprête à révéler qu’il est bien l’assassin, Lang choisit le point de vue des espions nazis, suspendus aux lèvres de la jeune femme. Dont la phrase suivante, adressée au médecin, commence par « You’re the one the Gestapo wants : you killed… » Evidemment, à cause de l’angle moral choisi par le film, le spectateur ne désire pas que les Nazis, qui attendent fébrilement la fin de la phrase, apprennent le nom du courageux meurtrier de Heydrich. Et après un silence la phrase se termine : « …any feelings I ever had for you », provoquant le soulagement du public : le plan suivant montre Svoboda tendant un papier à Mascha sur lequel il lui révèle la présence de microphones (comment le sait-il d’ailleurs ?) et c’est grâce à ce papier que Mascha a modifié in extremis la fin de sa phrase. Ouf ! Dans le même ordre idée, Brecht trouvait aberrant que le chef de la résistance, Dedic, se cache derrière un rideau pendant que la Gestapo fouille l’appartement de Svoboda. Probablement Bertolt ignorait-il qu’avec Fritz, tout est mise en scène. Car pendant que l’inspecteur Gruber interroge Svoboda, celui-ci se rend compte que quelques centimètres derrière Gruber, Dedic est en train de perdre son sang et qu’il va être découvert. Dans un ritardando insoutenable, Svoboda crée une diversion (« Puis-je vous offrir à boire, Inspecteur ? ») qui se révèle finalement être une ruse pour sauver les apparences (Svoboda renversera le vin sur la tache de sang pour les confondre et sauver ainsi temporairement Dedic).
Enfin, pour paraphraser un autre maître du suspense auquel Lang fut parfois – à tort – comparé, un bon suspense repose aussi sur le méchant de l’histoire. Si celui des Bourreaux meurent aussi était tout désigné par le contexte, il ne fallait pas pour autant le limiter à une figure figée, à un emblème du mal ; l’ennemi, dans le film, possède ainsi plusieurs facettes. Tout d’abord, celle du Reichsprotektor Heydrich, présent dans une seule scène, ce qui est largement suffisant pour le haïr. Arrogant, hystérique, marqué à la fois par la préciosité des mouvements et le phrasé particulier généralement attribués aux Nazis, il joue à être son propre Dieu, ou plutôt une copie de celui-ci, le portrait d’Hitler étant souvent présent dans le cadre au-dessus de lui. On retrouve un peu de cette figure archétypale du Nazi dans le chef de la Gestapo, Kurt Haas (droit comme un piquet, il se perce les boutons face au miroir tout en menant un interrogatoire), ou dans l’inspecteur chargé des interrogatoires, le faussement débonnaire Ritter, presque mielleux pendant qu’il torture Mme Dvorak, la marchande de légumes. Mais l’ennemi, dans Les Bourreaux meurent aussi, c’est aussi le traître, en l’occurrence le brasseur Czaka, collaborateur et capitaliste zélé. Toutefois, si la dernière partie du film se charge de le punir, le traitement que lui inflige le scénario n’est pas spécialement léger : bien qu’on y retrouve la thématique langienne du mensonge comme vecteur de la justice divine, avec un peuple qui s’unit d’un front (presque comme dans un lynchage) pour l’accabler, les circonstances de sa fin, le nez dans le caniveau, face à une église qu’il n’atteindra pas tant il ne mérite aucun espoir de rédemption, peuvent sembler un tantinet appuyées… Mais enfin, et de manière plus subtile, la menace nazie est aussi incarnée par l’inspecteur Gruber ; sous son chapeau melon et avec ses manières d’épicurien (bière et prostituée), il incarne une figure du Nazi plus charnelle mais aussi plus concrète. Il est le fonctionnaire appliqué, qui met son intelligence et sa logique au service du système nazi. Il est ce rouage intermédiaire qui permet à l’implacable engrenage de fonctionner de manière aussi terrible. Le duo du collabo couard et du flic rondouillard peut faire sourire quand il apparaît pour la première fois à l’écran, mais sa force dramatique, glaçante, vient de sa réalité : l’argent du brasseur et le zèle du fonctionnaire sont les carburants du monstre nazi. Il y eut durant la production du film de longues hésitations concernant son titre ; mais si le « Bourreau » était bien le surnom de Heydrich, il est clair que ce titre définitif fait avant tout référence à ces exécutants de base, qui par leur attitude condamnent tout un peuple à mort. Il est en ce sens symptomatique que la mort de Heydrich soit l’objet d’une ellipse tandis que celles de Czaka et de Gruber interviennent à l’écran : ces bourreaux-là ressemblent au peuple, et c’est à lui de les identifier pour survivre.
Le film fut un échec public et n’eut donc pas auprès des foules l’impact escompté. Lang poursuivit son effort de lutte anti-nazie avec, dans un style très différent, The Ministry of Fear puis Cloak and Dagger. Ironie du sort, des années plus tard, la censure jugea Les Bourreaux meurent aussi immoral parce que le film glorifiait le mensonge des masses et l’œuvre fut ensuite, pendant la guerre froide, soupçonnée d’être une apologie du communisme (John Wexley, d’ailleurs, fut black-listé) : ce qui devait donc être avant tout une célébration du courage collectif et une œuvre de rassemblement contre la barbarie se mit, pour d’autres raisons, à être regardée d’un œil suspect. Ce n’est que quelques décennies plus tard que l’œuvre fut en partie réhabilitée, notamment par la critique française. De fait, la sincérité et l’implication de Fritz Lang dans ce projet éminemment personnel ne doivent pas être mises en doute (et il est par ailleurs difficile de soupçonner l’auteur de sympathie avec la cause marxiste…) mais sont peut-être en partie responsable du déséquilibre manifeste d’un film fortement marqué par son contexte, et qui comblera probablement davantage les historiens que les plus fervents admirateurs du cinéaste.
(par Antoine Royer/DVDclassik)
ET L'ESPOIR RESTE VIVANT (par Ophélie Wiel pour CRITIKAT)
L’assassinat en juin 1942 par des résistants tchèques de Reinhard Heydrich, bourreau de la Tchécoslovaquie et l’un des plus fidèles serviteurs du régime nazi, est rarement relaté par les manuels d’histoire, déjà bien occupés à retenir les terribles faits de cette époque noire de l’humanité. En 1943, elle marque pourtant l’esprit de deux grands génies du cinéma allemand exilés aux États-Unis pour cause de non-adhésion à l’idéologie hitlérienne. Douglas Sirk signe alors son premier film américain, Hitler’s Madman, qui raconte la sinistre histoire du village de Lidice, rasé de la carte et dont les habitants mâles furent tous exterminés, après avoir vus leurs femmes et leurs enfants envoyés en camp de concentration en guise de représailles. Avec Les bourreaux meurent aussi, Fritz Lang donne une version très personnelle (et fausse historiquement, quoique cela n’ait pas beaucoup d’importance) de l’événement. Chargé d’idéalisme à une époque où l’on en avait bien besoin, ce film est aussi un chef d’œuvre du suspense langien. On comprend pourquoi le cinéaste en avait fait l’une de ses œuvres préférées.
Avec Hitler, objet de la satire féroce de Chaplin dans Le Dictateur (1940), de Lubitsch dans To Be or Not to Be (1943) ou risquant d’être tué avant l’accomplissement de son destin dans le fabuleux Man Hunt de Fritz Lang lui-même, Heydrich était un morceau de choix pour la propagande anti-nazie de Hollywood. Fou sanguinaire, il participa avec passion à l’élimination des SA en 1934 lors de la nuit des longs couteaux, et surtout joua un rôle déterminant dans la planification et l’organisation de la Shoah. Profondément antisémite, il alla jusqu’à faire vérifier par une commission nazie la pureté de ses origines allemandes… Fritz Lang ne concentre pourtant pas son film sur ce personnage, qui n’apparaît que dans les premières minutes; au fond, il n’est que le symbole de la barbarie hitlérienne, que ses subordonnés relayeront après son assassinat.
Cette barbarie, Lang la décline par des faits historiques avérés, et notamment par le recours récurrent à l’exécution d’otages dans les pays sous protectorat allemand, comme la Tchécoslovaquie, dont le peuple était considéré comme une race inférieure (la pancarte « interdit aux Tchèques et aux chiens » devant la devanture d’un night-club parle d’elle-même). Sans appuyer le propos pédagogique, Lang montre d’abord comment l’Allemagne se servait du pays comme d’une usine, n’ayant aucune considération pour les locaux, qui devaient « collaborer » unilatéralement, sans garantie d’en être récompensés. Mais, à la différence du film de Sirk, Hitler’s Madman, moins réussi, Les bourreaux meurent aussi est entièrement dépourvu de pathos. La scène de torture psychologique d’une vieille épicière par la Gestapo n’a rien de larmoyant; le film de Lang est avant tout une apologie de ceux qui surent rester dignes dans une période où il était plus facile de se laisser aller à la faiblesse…
A contrario de ce qu’on aurait pu attendre, Lang ne concentre jamais son film sur la description des horreurs nazies. Toutes les exécutions d’otages sont suggérées, les actes antisémites ne sont quasiment jamais évoqués. Le cinéaste se permet même de montrer les représentants de la Gestapo sous un jour quasi comique, comme dans cette scène où, espionnant par l’intermédiaire de micros l’appartement de la jeune femme soupçonnée de complicité dans le meurtre d’Heydrich, ils se rendent compte – croient-ils – qu’elle n’est au centre que d’une banale histoire d’amour. Car Les bourreaux meurent aussi, avant d’être une œuvre de propagande, est surtout un formidable film de suspense hollywoodien, avec force rebondissements, intrigues complexes, poursuites interminables et conclusion haletante. Prague, la capitale tchèque aux petites rues sombres et à l’atmosphère gothique, se prêtait bien au genre, même s’il ne s’agit évidemment que d’un décor de studio. Surtout, elle permet à Lang de revenir à ses amours expressionnistes (notamment par l’utilisation de la géométrie des décors) dans plusieurs scènes clés, telle la fuite de l’assassin d’Heydrich dans les ruelles, la dernière visite de l’héroïne à son père condamné à mort (à qui Lang offre le grand cliché du genre, celui du discours patriotique enflammé) et la magnifique scène finale, où le traître tchèque vient lentement expirer sur les marches de l’église…
Les bourreaux meurent aussi n’a pas de véritable héros, ou du moins Lang fait-il de l’ensemble du peuple tchèque son personnage principal. Filmant en intérieurs, sans grandes scènes de foule, Lang s’attache à une multitude de personnages, qui viendront tous, à leur manière, rejoindre le mouvement de la résistance. La recherche du meurtrier d’Heydrich par la Gestapo est prétexte à la découverte de petits actes quotidiens de sabotage, tout aussi nécessaires, selon le cinéaste, que les grandes actions de guerre. Comme dans Man Hunt, l’interrogation fondamentale du film est celle de la légitimation du meurtre: peut-on tuer un bourreau sans jamais devoir en répondre? En répondant par la positive et en concentrant le film sur la lutte non seulement contre l’ennemi allemand, mais aussi contre les traîtres tchèques, Lang signe un vibrant plaidoyer contre l’abattement et la capitulation (à l’origine, le film devait d’ailleurs s’appeler Never Surrender), en offrant au spectateur un magnifique pied de nez final, qui aurait presque pu être celui d’une comédie si le contexte n’était pas si tragique. Le très irréaliste happy-end (très prégnant dans la version française, amputée d’une bonne dizaine de minutes, heureusement présentes dans la version proposée à l’Action Écoles) doit ainsi se concevoir non pas comme une faiblesse scénaristique, mais comme la marque d’un idéalisme nécessaire.
Ironie de l’histoire, cette œuvre majeure de l’anti-nazisme fut blacklistée durant le maccarthysme sous prétexte que certains dialogues pouvaient être entendus comme « pro-communistes » (sic), et ne fut plus diffusée aux États-Unis avant les années 1970. Les bourreaux nazis étaient morts; ceux du cinéma étaient en marche.