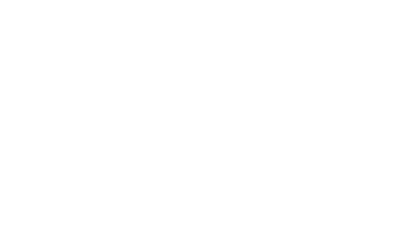OLIVIA : La fosse aux serpents.

N’en déplaise aux auteurs de la Nouvelle Vague, souvent expéditifs dans leur jugement du cinéma français des années 50, Olivia est une œuvre marquante qui mérite largement d’être redécouverte aujourd’hui. Plongeant le spectateur – et la protagoniste – dans un véritable nid de vipères, Jacqueline Audry dépeint un étrange pensionnat de jeunes filles divisé en deux “factions” rivales où tous les coups, même feutrés, semblent permis. Car c’est une authentique guerre de territoires – et des cœurs – que se livrent les deux maîtresses des lieux, Mademoiselle Julie et Mademoiselle Cara. Se disputant les faveurs de leurs élèves, elles suscitent des passions et des haines, mais aussi des retournements d’alliances inattendus. Sans jamais aborder l’homosexualité féminine comme un sujet de société, la réalisatrice ne porte aucun jugement sur ses personnages, mais envisage plutôt la découverte de l’amour et l’éveil des sens des pensionnaires avec bienveillance. Seules les deux mantes religieuses, Julie et Cara, sont présentées comme manipulatrices, sans que leur orientation sexuelle entre en jeu pour autant : c’est davantage le pouvoir que le désir charnel qui semble les animer.
Film étourdissant et singulier, Olivia est un régal de mise en scène. Enfermant ses jeunes comédiennes dans un espace sombre et confiné qui n’est pas sans rappeler le Rebecca d’Hitchcock, Jacqueline Audry orchestre une circulation des personnages autour de l’escalier de la pension : c’est un espace circulaire à partir duquel les adolescentes observent les autres, mais aussi un point de passage entre les salles de cours et les chambres des pensionnaires, menant par ailleurs aux appartements de Julie et Cara. De même, les nombreux couloirs, antichambres et vestibules du bâtiment, évoquant un château de conte de fée, distillent une atmosphère d’étrangeté à la limite du fantastique.
C’est donc un univers sans homme auquel s’attache Jacqueline Audry. Une forme de gynécée où les uniques représentants du sexe fort – magistrats et policiers – ne sont que des pantomimes aperçus de dos ou de profil, semblant appliquer la loi de la société sans s’intéresser aucunement à ce qui se déroule entre les murs du pensionnat. Cette indifférence toute masculine aux émotions et aux souffrances féminines est emblématique du patriarcat à l’œuvre au début des années 50. Évitant là encore toute velléité contestataire, la cinéaste signe en réalité un film foncièrement féministe. Autant dire que dans la France corsetée de l’époque, où l’homosexualité était largement considérée comme déviante et où les femmes étaient jugées inférieures aux hommes, Olivia a été accueilli comme une œuvre dégénérée. Une raison supplémentaire pour la redécouvrir de toute urgence.
Edwige Feuillère : La noblesse à l'état pur.

Née en 1907 d’un père italien et d’une mère alsacienne, Edwige Feuillère possède d’étonnantes prédispositions pour la comédie. En effet, dès l’âge de 7 ans, elle récite les fables de Maurice Rollinat, réputés pour leur difficulté, et les sonnets de Dante dans le texte ! Dès 1931 – elle n’a que 24 ans ! –, elle entre à la Comédie-Française.
Avec son charisme et son port altier, elle démarre pourtant dans des rôles de femme légère, comme Une petite femme dans le train (1932) de Karl Anton. Après avoir joué les vamps dans Topaze (1932) de Louis Gasnier, elle devient célèbre en s’exposant dans le plus simple appareil dans Lucrèce Borgia (1935) d’Abel Gance. Sous l’Occupation, elle acquiert un statut de star : elle tourne sous la direction de Max Ophüls dans De Mayerling à Sarajevo (1940), puis avec La duchesse de Langeais (1942) de Jacques de Baroncelli, elle livre une interprétation de grande classe de l’héroïne balzacienne.
Après la guerre, elle s’illustre dans L’aigle à deux têtes (1947) de Jean Cocteau qui la qualifie de “reine des neiges, du sang, de la volupté et de la mort”. Elle trouve là sans doute son plus grand rôle. Pourtant, davantage passionnée de théâtre, elle se retire progressivement des écrans. On la retrouve de temps en temps au cinéma, d’En cas de malheur (1957) de Claude Autant-Lara, aux côtés de Brigitte Bardot, à La chair de l’orchidée (1974) de Patrice Chéreau. Côté télévision, elle s’est produite dans Les dames de la côte (1979) de Nina Companeez et Le tueur triste (1984). Elle disparaît en 1998, à l’âge de 91 ans.
Simone Simon : Le charme félin.

Née en 1911, Simone Simon est d’abord mannequin avant de devenir créatrice de mode. Passionnée par la scène, elle enchante les spectateurs de théâtre. Repérée par Marc Allégret, qui lui confie de petits rôles dans Mam’zelle Nitouche (1931) et i (1932), elle décroche une partition plus ambitieuse dans Le lac aux dames (1934) et Les beaux jours (1935) du même cinéaste.
Un an plus tard, c’est au tour du légendaire producteur hollywoodien Darryl Zanuck de tomber sous le charme de la comédienne et de lui offrir un contrat avec la Fox : elle tourne dans Girls’ Dormitory (1936) d’Irving Cummings ou encore Josette (1938) d’Allan Dwan. Mais le public américain la boude. Elle retourne alors en France et enchaîne La bête humaine (1938) de Jean Renoir, aux côtés de Jean Gabin, et Cavalcade d’amour (1940) de Raymond Bernard.
C’est encore une rencontre décisive avec un jeune producteur talentueux, Val Lewton, qui marque un tournant dans sa carrière. En effet, grâce à lui, elle décroche son plus beau rôle avec La Féline (1942) de Jacques Tourneur où son mélange détonant de fragilité et de férocité fait d’elle l’une des femmes fatales les plus troublantes du cinéma. Malheureusement, sa carrière ne décolle toujours pas et Simone Simon décide, une nouvelle fois, de rentrer en France.
Comédienne pour Max Ophüls, de La Ronde (1950) au Plaisir (1952), elle se consacre ensuite au théâtre, délaissant totalement le cinéma qui n’a jamais su reconnaître pleinement son talent singulier. Elle disparaît en 2005, à l’âge de 93 ans.
Jacqueline Audry : L'insoumise.
Celle qui a longtemps été la seule femme réalisatrice de France ne s’est pas imposée sans mal dans un milieu foncièrement sexiste. Fille de préfet, elle multiplie les métiers subalternes – traditionnellement féminins – avant de participer à un film publicitaire. Elle a alors une révélation : elle veut passer derrière la caméra ! Mais dans les années 30, une telle ambition est loin d’être facilement réalisable.
D’abord scripte, puis assistante de grands metteurs en scène comme Pabst et Ophüls, elle signe son premier court métrage en 1943, avec Les Chevaux du Vercors. Trois ans plus tard, elle passe au long avec une adaptation des Malheurs de Sophie où l’héroïne est une adolescente féministe et politisée : non seulement elle refuse le mariage arrangé qu’on cherche à lui imposer, mais elle se pose en républicaine affirmée. Dès la fin des années 40, elle adapte Colette, son écrivain préféré, de Gigi (1949) à Minne, l’ingénue libertine (1950) et Mitsou (1956). “Les combats menés par la femme pour sa liberté, dans la société, dans la famille, en amour, m’ont toujours fascinée”, raconte-t-elle.
Sans jamais craindre la critique ou les conventions sociales, elle signe aussi une adaptation du roman à scandale de Victor Margueritte, La Garçonne (1957), et transpose le Huis Clos (1954) de Sartre. En 1959, dans Le secret du Chevalier d’Eon, une jeune femme, dans la France patriarcale du XVIIIème siècle, devient une fine lame à l’égal des hommes. Une insoumise comme l’était Jacqueline Audry, injustement décriée par les cinéastes de la Nouvelle Vague.
TEXTES : Franck GARBARZ
Portrait : Jacqueline Audry, la pionnière oubliée du 7e art (TEXTES : WWW.CNC.FR)