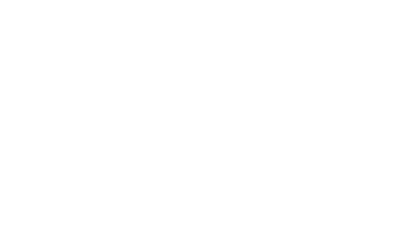Le Grand Retournement
Un film de Gérard Mordillat
Sortie en salles : 23 janvier 2013
Visa n°133017
France, 2012, 1h17, DCP
C’est la crise, la bourse dégringole, les banques sont au bord de la faillite, le crédit est mort, l’économie se meurt… Pour sauver leurs mises les banquiers font appel à l’…tat. L’…tat haï est soudain le sauveur ! Les citoyens paieront pour que le système perdure, que les riches restent riches, les pauvres pauvres. Adapté de la pièce de Frédéric Lordon cette histoire d’aujourd’hui se raconte en alexandrins classiques. C’est tragique comme du Racine, comique comme du Molière…

— Galerie
GÉRARD MORDILLAT — ENTRETIEN
Qu’est-ce qui vous a donné envie d’adapter la pièce de théâtre dont est tiré Le grand retournement ?
J’ai lu D’un retournement l’autre quasiment à sa publication et j’ai immédiatement appelé Frédéric Lordon pour lui demander de n’en céder les droits à personne. Il n’y avait que moi pour en faire un film ! Un film qui, selon la magnifique définition de Jean Cocteau, serait « un objet difficile à ramasser ». Je trouvais le texte brillant, très drôle et très fin, sans compter que je partageais en tous points l’analyse économique et financière qu’il proposait. Il est vrai aussi que j’aime faire des films à partir de textes qui ne sont pas a priori cinématographiques, comme En compagnie d’Antonin Artaud d’après le journal de Jacques Prevel. Le journal d’un jeune poète qui passe ses journées en quête de nourriture et ne pense qu’à écrire n’est pas par nature l’objet idéal pour un scénariste ni ce qui excite d’emblée les producteurs. La pièce de Frédéric Lordon portait en elle le même genre de défi.
Quels aménagements avez-vous apportés au texte de Frédéric Lordon pour en faire un film ?
La pièce de Frédéric Lordon a été écrite d’abord pour être lue, ensuite éventuellement pour être jouée mais je ne crois pas que la dimension scénique ou cinématographique ait été la préoccupation centrale de l’auteur. Il fallait donc l’amener au cinéma, l’adapter. Mon travail s’est déroulé en deux temps. D’abord j’ai fait éclater le texte pour répartir les répliques entre les rôles et définir le caractère des personnages, le banquier Franck serait dans le registre ” ecclésiastique “, le banquier Pater serait l’ami de toujours, le banquier Barbin un illuminé, le premier deuxième conseiller, Benjamin Wangermée, serait comme un écureuil fou, son remplaçant jouerait Hernani etc… Ensuite autour d’une table, avec les acteurs, nous avons confronté mon adaptation aux nécessités de l’oralité, nous avons travaillé à la ” mettre en bouche ” si vous préférez. Par exemple, dès la première lecture, Jacques Weber nous a suggéré de ” faire du Rostand “, c’est-à-dire non seulement répartir les répliques, mais ne pas hésiter à donner trois mots d’un vers à l’un, trois à l’autre et six au dernier, ce qui souligne immédiatement l’humour du texte. Lecture après lecture, je crois que c’est autour de cette table que le film s’est construit, quand chaque acteur s’est emparé des alexandrins de Lordon pour les faire siens, pour qu’ils leur passent dans les moelles jusqu’à paraître absolument naturels et quotidiens. L’enjeu était de faire du cinéma, pas du théâtre ! Dès lors n’avons-nous pas hésité à modifier tel ou tel vers pour aller toujours vers plus de simplicité tout en respectant à la lettre le texte de Frédéric Lordon.
Il a suivi ce travail ?
Tout a été fait avec son accord. Jour après jour, je lui soumettais nos modifications… Ce qui d’ailleurs l’invitait à nous en proposer d’autres !
Selon quels critères avez-vous choisi vos interprètes ?
Pour leur talent bien sûr, pour leur expérience des alexandrins mais aussi pour leur capacité à s’engager sur un tel texte, à relever le défi qu’il représentait et en partager les conclusions. Ce n’a pas été difficile de les convaincre. Tous ont dit oui tout de suite ! Aussi vite que Véra Belmont m’a dit oui pour produire le film… C’était le même enthousiasme des deux côtés.
Vous n’aviez jamais travaillé avec Jacques Weber ?
Je connais Jacques depuis le Conservatoire, nous nous sommes promis cinquante fois de tourner ensemble sans jamais parvenir à le faire, eh bien Le Grand Retournement nous offrait enfin l’occasion que nous cherchions. Surtout que, dans le domaine de l’alexandrin, Jacques Weber est pour moi un premier violon extraordinaire. Je n’avais jamais tourné non plus avec Alain Pralon. Il m’a fait confiance par amitié comme Edouard Baer qui regrettait encore que je n’aie pu lui trouver un rôle dans les Vivants et les morts. Les autres acteurs étaient tous dans mes précédents films. Cela signifie que j’ai fait le casting avec ma troupe au sens large ! Comme il n’y avait que des personnages masculins dans la pièce de Lordon, j’ai aussi attribué des rôles à deux actrices que j’adore : Odile Conseil et Christine Murillo.
Le rôle du nouveau ” deuxième conseiller ” est-il d’être le porte-parole de l’auteur ?
Cela me paraît évident ! C’est aussi le mien. Et c’était d’ailleurs la principale difficulté pour Patrick Mille qui, contrairement à d’autres, n’avait pas de ” morceau de bravoure ” pour se mettre en valeur. Il devait jouer avec une grande détermination intellectuelle, philosophique et politique. Cela impliquait non seulement de posséder parfaitement le texte mais, plus encore, d’être si complétement en accord avec lui qu’à aucun moment il ne puisse donner l’impression de dérouler un collier de citations. Sa performance est à la hauteur de cette difficulté.
La première fois qu’on découvre le Président de la République, il tient à la main une manette de console vidéo. Faut-il y voir un message particulier ?
Pour moi Elie Triffault, qui incarne ce rôle du Président, c’était Hamlet. Le spectateur devait sans cesse s’interroger pour savoir si le président était un enfant idiot ou le plus rusé d’entre tous. Comme Hamlet c’est un enfant monstre, fou et lucide à la fois. Et sa manette de console vidéo représente en quelque sorte le crâne de Yorick [rires] !
Comment avez-vous contourné l’écueil du théâtre filmé ?
J’avais déjà connu deux expériences dans ce domaine, les Sonnets de Shakespeare qu’avaient mis en scène Jean Jourdheuil et Jean-François Peyret et Architruc d’après Robert Pinget. Le théâtre m’inspire mais je me garde bien d’en copier les effets ou pire, de l’illustrer. Filmer le théâtre, c’est ma façon de l’apprivoiser, de l’arracher à la scène. Je ne tourne pas de “captation”, je le fais mien en en faisant du cinéma. C’est toujours une mise-en-scène originale. Le Grand Retournement paye sa dette au théâtre par l’usage de l’alexandrin et s’en affranchit aussitôt en oubliant les planches pour ne connaître que le cadre et sa lumière.
C’est vrai que la photo est très réussie… Qu’elle ne donne jamais l’impression d’une ” lumière de théâtre “.
François Catonné, le chef opérateur, et moi sommes complices depuis plus de trente ans. Nous préparons très longuement chaque tournage et sur le plateau notre challenge est que l’un doit toujours avoir une idée de plus que l’autre. Que ce soit sur le terrain documentaire ou dans la fiction, nous partageons l’idée d’un cinéma inventeur de formes, inventeur d’images dont l’esthétique exprime toujours notre point de vue sur ce que nous tournons. J’ai envie de préciser : notre point de vue moral et politique.
Comment avez-vous choisi la musique ?
J’ai donné une seule indication au compositeur : il faut traiter le genre et que la musique porte en elle l’ironie du texte, son lyrisme aussi. Elliott Covrigaru a suivi la piste Kurt Weil… et c’était la bonne piste. La musique et le texte ne font qu’un, ce sont deux discours jumeaux dans des registres différents. C’est une musique que j’aime beaucoup…
Où le film a-t-il été tourné ?
Nous avons tourné dans l’usine Babcock d’Aubervilliers dont j’avais déjà utilisé un bureau désaffecté pour une scène des Cinq parties du monde.
Pourquoi avez-vous choisi pour décor cette friche industrielle à l’abandon ?
Il y avait une chose dont j’étais certain : je ne voulais pas tourner dans les ors de la République ; cela aurait été totalement pléonastique d’aller filmer dans un palais ou je ne sais quelle institution. J’ai également évacué l’éventualité de tourner dans un décor hyper moderne avec de grandes surfaces vitrées ; décor qui aurait signifié une dépendance totale par rapport à la météo, une structure plus lourde sur le plan technique et d’autant moins de temps pour les acteurs. L’idée de la ruine industrielle s’est très rapidement imposée. Elle renvoie métaphoriquement à la destruction absolue provoquée par la crise financière et bancaire. C’est un décor de désolation. Les lieux gardent la trace de leur splendeur passée dont il ne reste que des vestiges, ferrailles, gravats, effondrements ; la banque centrale n’est plus qu’un trou et l’…lysée un pan de mur… Dans cet espace, dans ce désastre architectural si photogénique, je pouvais à la fois faire du cinéma et laisser du champ aux acteurs sans les contraindre à l’excès.
Pourquoi avez-vous utilisé des images d’archives ?
Il me semblait important de figurer cette idée de l’effondrement, cet “avant” de la ruine. Et puis, à la fin du film, je voulais que le peuple prenne possession de l’image. Ce sont peu de plans mais ils nous ancrent de façon certaine dans le réel, dans le ici et maintenant. Le film n’est pas un conte philosophique ni un exercice de style, c’est un essai critique très radical sur le fonctionnement du capitalisme, sur ses dérives, sur les catastrophes que provoque la quête éperdue du profit. C’est du réel, du contemporain, presque du documentaire, d’où l’appel aux archives.
Le livre est paru en mai 2011. Entre-temps, la situation politique a changé. En avez-vous tenu compte ?
Les acteurs, Frédéric Lordon et moi-même étions d’accord sur le fait qu’il n’y avait aucun réaménagement à opérer. Que ce serait une erreur de vouloir coller à l’actualité. La mise en cause de la politique néo-libérale d’un gouvernement de droite l’est encore aujourd’hui – et peut-être de façon beaucoup plus cruelle – sous un gouvernement de gauche. La force de l’analyse de Frédéric Lordon, c’est qu’elle traverse le temps. La critique que l’on peut faire aujourd’hui des institutions bancaires, de la Banque Centrale Européenne, de l’asservissement du politique à l’économie est tout aussi fondée qu’elle l’était il y a trois ans. La question qui se pose, et qui se posera à ceux qui verront le film en 2013 : comment se fait-il qu’un gouvernement socialiste élu par une majorité populaire poursuive une politique économique et financière au détriment absolu des intérêts de ses électeurs ?
Vous écrivez des livres, vous réalisez des films, des fictions comme des documentaires. Quel lien établissez-vous entre ces diverses activités ?
Pour moi, tout cela, c’est de l’écriture, qu’elle soit littéraire ou cinématographique. Je ne vois pas pourquoi je me priverais de tous les moyens qui sont à portée de ma main et de mes yeux. Alors j’écris des romans, des essais, des poèmes, des scénarios, je tourne sur les origines du christianisme, sur le discours patronal, sur Antonin Artaud, des drames, des comédies, des clips avec Renaud, Billy-ze-Kick, Fucking Fernand et tant d’autres choses… parce que je ne connais rien de plus accablant que la monotonie. Je combats cette idée de la spécialisation héritée du XIXe siècle qui voudrait que l’on ne fasse qu’une chose répétée à l’infini. Je ne me répète pas, je ne me retourne pas, j’avance entre livres et films. Définitivement, le cinéma et la littérature s’allument pour moi de feux réciproques et il n’y a pas de hiatus entre ce que je tourne et ce que j’écris.
Qu’attendez-vous du Grand retournement ?
J’espère que le public ressentira le côté jubilatoire de cette comédie sérieuse, le plaisir qu’il y a à comprendre par cette voie si inattendue la situation économique et financière dans laquelle nous sommes et à l’analyser. Cela me comblerait. Pour moi, le cinéma reste un extraordinaire outil critique et ici l’alexandrin, loin d’égarer le spectateur, il suscite une écoute particulièrement aigüe de ce qui se dit et qui se dit si bien que l’on rit alors qu’on devrait pleurer.
FR…D…RIC LORDON — ENTRETIEN
Comment avez-vous eu l’idée d’écrire D’un retournement l’autre ?
Si je vous dis que l’idée m’est venue en passant l’aspirateur, est-ce que vous y voyez une réponse susceptible de faire sens et d’éclairer quoi que ce soit ?
Pourquoi avez-vous choisi la forme du théâtre, qui plus est en vers ?
La réponse présentable, pour ainsi dire officielle, et d’ailleurs pas entièrement fausse, tournerait très généralement autour de l’idée de remettre de la politique dans le théâtre en temps de crise historique du capitalisme mondialisé, et puis dirait le paradoxe d’aborder des problèmes très contemporains, parfois même techniques, de l’économie et de la finance, dans une forme délicieusement surannée, remise au goût du jour à l’occasion d’événements pour laquelle elle semble le plus incongrue possible. La vérité vraie est un peu différente. J’ai trop de respect pour la littérature pour me prendre pour un littérateur. C’est pourquoi il me fallait une manière d’entrer en littérature sans en avoir l’air et d’une certaine manière qui désamorce ostensiblement toute prétention, formelle ou autre. De ce point de vue, l’alexandrin était une magnifique couverture : toute la créativité formelle est déjà là, déposée dans le genre même, et m’exonère visiblement de toute revendication en cette matière. Je pouvais donc m’adonner à l’alexandrin comme on s’adonne à un exercice de style, dont on sait d’ailleurs qu’il était communément pratiqué par les potaches (d’il y a quelques générations) ou par des sous-préfets à la retraite. Mais il faut tenir ensemble les deux aspects de cette duplicité, que je reconnais sans difficulté : s’il avait à mes yeux la vertu de m’offrir une protection idéale, l’alexandrin n’en produit pas moins objectivement tous ses effets d’incongruité qui en justifient entièrement l’usage.
Gérard Mordillat m’a expliqué que votre pièce était davantage destinée à être lue qu’à être jouée. Partagez-vous cette position et comment la justifiez-vous ?
C’est que je suis un néo-dramaturge sans vision théâtrale ! Mon affaire à moi, c’est le texte, et j’ai écrit en m’immergeant dans les mots, les mètres et les rythmes, mais sans aucune idée scénographique… et confiant en les vertus de la division du travail c’est-à-dire en me disant que ce serait l’affaire des adaptateurs et des metteurs en scène. De ce point de vue je me dis que ça n’était pas un mauvais calcul…
Votre texte contient des références directes à l’actualité : le fameux « Je suis à la tête d’un état en faillite » de François Fillon, par exemple. Pourquoi les personnages ne sont-ils pas nommés ?
Je voulais faire un théâtre d’archétypes, sans profondeur, sans psychologie ni états d’âme, avec des personnages réduits à l’état de simples supports des forces sociales qui s’emparent d’eux et qui parlent pour eux. Les banquiers, les conseillers, le journaliste, le trader : tous sont des génériques. Cependant, oui, il y a un président de la république et un premier ministre qui nous rappellent quelque chose… J’admettrai cependant volontiers qu’on me dise que ces deux personnages-là, en fait surtout celui du président – que leur potentiel de bouffonnerie suggérait fortement de convoquer intuitu personae – auraient pu tout aussi bien être « généricisés » comme les autres. L’alternance sans alternative de mai 2012 atteste suffisamment l’indistinction des occupants du pouvoir, devenus fongibles, rouages indifférents dévoués à la même politique économique asservie aux intérêts des créanciers et du capital.
De quelle manière avez-vous travaillé sur l’adaptation avec Gérard Mordillat ?
Il fallait d’abord faire des coupes car le texte intégral aurait été trop long. Il y avait également lieu de tronçonner quelques longues tirades qui, à l’écriture, devaient beaucoup au plaisir d’enchaîner les vers, mais menaçaient de faire tunnels à la scène. Enfin il y a le cas François Morel. Gérard lui a confié le rôle du premier conseiller et il faut bien avouer qu’en serviteur obséquieux, il est assez prodigieux. Mais avoir un tel comédien et lui donner si peu à dire – car le rôle du « premier conseiller » est finalement assez mince -, c’était vraiment dommage. Nous avons donc réécrit des répliques spécialement à son attention.
Gérard Mordillat a avoué qu’il aurait Idéalement adoré réaliser une comédie musicale sur ce sujet. Qu’en pensez-vous ?
Je pense que toutes les inventions scénographiques, même les plus improbables a priori, étaient bonnes à envisager, et que si on a mis de l’alexandrin sur les subprimes, on peut bien y mettre aussi de la comédie musicale. Il se trouve que Judith Bernard, qui a mis en scène la pièce mais pour le théâtre, y a introduit beaucoup de passages chantés avec un accompagnement piano-cabaret, et ça marche vraiment très bien.
Êtes-vous venu sur le plateau pendant le tournage et que pensez-vous du parti pris esthétique qui consistait à prendre pour cadre une friche industrielle ?
Je n’ai évidemment pas manqué de venir sur le tournage. D’abord comme un curieux saisissant sa première occasion de mettre les pieds sur un plateau. Ensuite pour rencontrer tous les gens, acteurs et techniciens, à qui je dois finalement que ce texte passe à l’écran. Le choix de ce lieu industriel abandonné entre typiquement dans la série des décalages de tous genres, formels et scénographiques, auxquels pouvait donner lieu cette affaire. En l’occurrence, la friche industrielle pour signifier le chaos d’un monde sur le point de faire ruine, je me dis rétrospectivement que ça se posait presque comme une évidence : c’est que le “retournement” est aussi un effondrement.
Avez-vous été consulté sur la distribution des rôles ?
Gérard m’a informé… et je ne pouvais que valider ses choix ! L’homme de la situation, ici, c’était lui ! Je ne pense pas révéler un secret d’état en disant qu’il a fait venir cette brochette d’acteurs en jouant plus sur les ressorts de l’amitié que sur ceux de l’incitation financière. Que des acteurs de cette trempe – auxquels il faudrait joindre tous les techniciens de l’équipe de Gérard – aient accepté de s’embarquer dans cette affaire dans ces conditions est un fait qui mérite aussi d’être mentionné.
Dans le post-scriptum de votre pièce intitulé “surréalisation de la crise”, vous militez notamment pour un art engagé. Comment expliquez-vous sa disparition ?
Il faut bien voir que nous ne devons qu’à la révélation tardive des dégâts de la mondialisation et puis a fortiori à cette crise de magnitude historique d’avoir réarmé la critique, et surtout de l’avoir diffusée dans tous les secteurs de la création : pas seulement les sciences sociales ou la philosophie, mais également les documentaires, la littérature, les arts plastiques, le cinéma, le théâtre, la BD même. La grande, la réjouissante nouveauté, donc, c’est que les arts parlent de nouveau du monde, je veux dire du monde historique. Après les années rouges, le néo-libéralisme, à partir du milieu des années 80, nous a fait vivre un terrible tunnel d’apathie critique, le vrai drame étant que l’art, dont ce serait normalement la vocation que de tenir une position contracyclique, c’est-à-dire de parler contre l’air du temps, a alors déserté la scène critique à son tour. Il est vrai que l’“art engagé”, l’“art politique”, ne s’était pas toujours signalé par sa finesse, et qu’il y avait parfois quelque chose de pénible, politiquement et artistiquement, dans cet art édifiant et magistral, émetteur de vérités et donneur de leçons. Mais le balancier est reparti beaucoup trop loin dans l’autre sens, et l’abandon du terrain politique par l’art, se considérant du même coup “autorisé” à se laisser prendre avec délice par toutes les forces de la marchéisation et de la financiarisation, aura été à l’image de toute une époque, l’époque néo-libérale, qu’il lui appartenait normalement de combattre. Bien sûr, on ne peut pas soumettre l’art à l’alternative d’être politique ou de ne pas être ! Mais une désertion aussi générale, pour ne rien dire du degré de corruption marchande qui l’a accompagnée, restera comme un fait d’époque aussi accablant que caractéristique. C’est cette époque qui est en train de se refermer. En résumé, je ne “milite” pas pour un art engagé, mais je me réjouis qu’il y en ait de nouveau un !